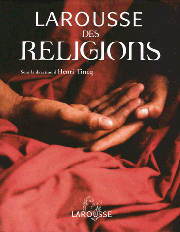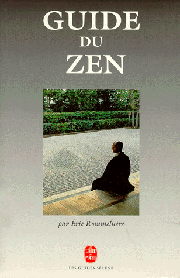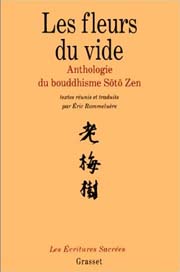Réincarnation III
Primes réflexions sur le questionnement de Thomas :
On le sait, les traditions bouddhistes décrivent notre condition d’être sentant et vivant sous la forme du samsâra, le cycle de la vie et de la mort. La foule des êtres renaît sous différentes formes, six en tout : les êtres infernaux, les esprits affamés, les animaux, les êtres humains, les titans et les dieux (les pretas, les esprits affamés, sont des sortes de gnomes difformes au long cou qui ne peuvent assouvir leur faim ; les asuras sont des titans belliqueux parfois confondus avec les dieux). À chaque forme correspond un domaine de renaissance, depuis les enfers jusqu’aux paradis. Le processus karmique est le moteur des renaissances. Les vies futures et leurs conditions, loin d’être distribuées de façon aléatoire, sont modelées par la qualité morale des actes, les uns entraînant vers de plaisantes destinées, les autres vers les affres et les tourments. On ne peut ignorer que le samsâra a été entendu par les bouddhistes eux-mêmes comme une vérité et le karma comme une loi naturelle et quasi physique. Le processus karmique serait une forme de justice immanente, où tout ce que nous ferons trouvera sa rétribution. Il expliquerait un certain nombre d’états, qu’ils soient heureux ou malheureux. Le muet en cette vie aurait inévitablement menti dans une autre vie ; le pauvre expierait quelques vols ou larcins commis dans ses existences antérieures. Plus généralement, les handicapés, les pauvres, les femmes mêmes, ne feraient que s’acquitter de leurs fautes. Évidemment, l’inscription du karma dans les lois de la nature conduit à une forme de déterminisme qui justifie et rationalise les souffrances.
Pourtant, à l’encontre de cette vision naturaliste, les traditions bouddhistes sont traversées par une autre perspective qui conçoit le dharma, non comme une doctrine qui dirait le vrai sur le monde, mais comme une démarche qui propose une orientation en ce monde (l’Orient étant ici l’éveil, conçu comme le dénouement irrévocable de l’angoisse et de la peur). Cette autre approche se trouve développée dans les Écritures indiennes des traditions de la Grandeur (mahâyâna). Le Sûtra du Lotus et le Sûtra de Vimalakîrti rejettent ainsi toute explication métaphysique, insistant en revanche sur l’habileté consommée du Bouddha à produire des dispositifs de langage. Dans cette perspective, l’association du karma et du samsâra, en intégrant la totalité des actes dans la sphère du devenir, doit être comprise comme un mythe.
Sous le vocable de mythe, il ne convient pas d’entendre une forme narrative plus ou moins élaborée (comme peut l’être la légende de Tristan et Iseult), mais une représentation collective qui structure l’existence des individus et des communautés. Ainsi, le triptyque de la création du monde, de la parole de Dieu et de l’humanité du Christ a formé des siècles durant le grand mythe structurant de l’Occident. Leur conjugaison n’a pas simplement proposé une relation singulière entre Dieu, l’Homme et la nature, elle a produit une société qui se pense en son devenir, avec ses institutions (l’Église et la royauté) et ses acteurs. Le mythe possède une fonction englobante, il interprète le monde et intègre la totalité du vivant en quelques signes. Il produit un imaginaire, des représentations, des valeurs ainsi que des attitudes et des comportements individuels et collectifs.
Comme plusieurs chercheurs l’ont relevé, une lecture attentive des récits canoniques et extra-canoniques du bouddhisme ancien montre que la soi-disant « loi » du karma n’a pas la rigueur qu’on lui prête trop facilement [1]. Car ces récits n’ont nul besoin d’être « vrais » pour être justes. Tout comme un roman ou un film, ils peuvent jouer de l’ellipse, comporter des incohérences ou des inconsistances. Leur puissance émotive (et motrice) ne se confond pas avec le plausible. Ils affirment que non seulement nos actes ont des conséquences objectives, mais qu’ils se réverbèrent dans notre subjectivité. Ils affirment un monde humain, riche de valeurs et de significations, de beautés et de tristesses, un monde dans lequel chacun joue à chaque instant la grandeur de sa vie.
Toute tentative de prouver ou d’infirmer le karma et le samsâra manque la signification de leur invisibilité et de leur invérifiabilité. Pour apprécier pleinement le langage du mythe, il nous faudrait également nous défaire d’une conception qui a longuement informé la pensée occidentale et qui dissocie la raison de l’imagination. Dans nos représentations culturelles, un mythe paraît toujours subordonné à la pensée intellectuelle ou philosophique, il ne peut être que la forme dégradée et obscurcie d’une véritable histoire ou bien encore l’expression d’un archétype. Cette dévalorisation débute avec les Grecs eux-mêmes qui opposaient le muthos au logos (le mythe à la vérité) alors que les termes, synonymes et interchangeables dans la haute antiquité grecque, désignaient simplement la parole. Le mythe n’est pourtant pas une forme inférieure ou antérieure de la pensée ; il s’agit d’une autre de ses modalités, productrice de sens et d’effets, qui doit être appréhendée dans sa propre fonction sans espérer d’autre vérité que son expression. Si des philosophes contemporains, Jacques Derrida, Paul Ricœur, Richard Rorty ou d’autres, ont reconsidéré la fonction mythique, leurs travaux n’ont pas suffi pour que nos âmes se réapproprient autrement les mythes. Il nous faudrait un autre mot qui soit à même de recoudre le muthos et le logos. En sanskrit, le terme de sûtra (au sens propre, « le fil ») évoque précisément cette couture. Dans ces formes littéraires et narratives, la parole du Bouddha fait sans cesse confluer la réalité et la fiction. Les dissocier serait une mésentente. Ainsi, le samsâra, où chacun endure le déplaisir et le plaisir, n’est pas une vérité mais un espace de signification. Les six mondes forment une géographie narrative qui permettent d’appréhender autrement le monde et de l’habiter. Ils n’ont nul besoin d’explication ni de justification.
Le mythe s’impose comme une vision collective qui sature le regard. Notre vision occidentale du déploiement de la condition humaine dans le temps et dans l’espace est bien différente de celle des Indiens. Les bouddhistes occidentaux ne peuvent approcher cet autre cadre de l’agir et du devenir que sous la forme personnelle de la croyance ou de l’incroyance. Malgré des positions parfois très accusées, la littérature et la réflexion sur le karma et les renaissances restent mineures dans les pays non asiatiques et ne font guère l’objet de débats. Cette vision cosmique est plus ignorée que critiquée, déniée ou revisitée, car elle ne signifie rien dans nos structures narratives. L’image des six mondes ne peut paraître qu’artificielle et aboutir au rejet, ou plus sûrement au désintérêt. Seule une lecture à neuf des sûtras qui maintiendrait l’indispensable suture entre la fiction et la réalité serait à même de restaurer l’entente du karma, sa valeur émotive, motrice et mobilisatrice.
Jamais l’association du karma et du samsâra ne devrait être comprise comme la justification d’une morale du devoir ou du conformisme. Le karma désigne le pouvoir de l’acte et non une croyance. Agir nous engage à nous extraire de la mécanicité de nos vies, non à l’acceptation ou à la démission qui ne créent que de l’indifférence. Dans sa dimension mythique, l’association offre une autre morale conçue comme un élargissement de la pensée et de l’agir. L’agir est l’expression d’un être qui se perçoit vivant dans le monde. Ce que je suis se transforme alors en ce que je fais, et ce que je fais n’est rien d’autre que ce monde où je vis. Le désir dans son émergence fabrique le monde, mais plongé dans ce monde, celui-ci affecte, construit et reconduit mon existence. Telle est, pour un disciple du Bouddha, la signification de la renaissance.
Nul ne renaît seul. Ce monde n’est pas le domaine solitaire de quelques agissements personnels, il est un monde partagé. En agissant, non seulement je m’engage en ce monde, mais j’engage à mon tour, même dans le plus infime de mes actes, un à un, tous les êtres qui s’y meuvent. Nos actes ont une épaisseur et une gravité – une signification. Les domaines de renaissance désignent aussi des espaces d’interlocuteurs. Ils peuvent non seulement interagir mais également interpréter le sens de mes actes. Il s’agit de communautés d’interprétation.
Note 1 : James R. Egge, Religious Giving and the Invention of Karma in Theravâda Buddhism, Richmond, Curzon Press, 2002 ; Jessica Main, « The Karma of Others: Stories from the Milindapanha and the Petavatthu-atthakathâ », Journal of Buddhist Ethics, 2005.
On le sait, les traditions bouddhistes décrivent notre condition d’être sentant et vivant sous la forme du samsâra, le cycle de la vie et de la mort. La foule des êtres renaît sous différentes formes, six en tout : les êtres infernaux, les esprits affamés, les animaux, les êtres humains, les titans et les dieux (les pretas, les esprits affamés, sont des sortes de gnomes difformes au long cou qui ne peuvent assouvir leur faim ; les asuras sont des titans belliqueux parfois confondus avec les dieux). À chaque forme correspond un domaine de renaissance, depuis les enfers jusqu’aux paradis. Le processus karmique est le moteur des renaissances. Les vies futures et leurs conditions, loin d’être distribuées de façon aléatoire, sont modelées par la qualité morale des actes, les uns entraînant vers de plaisantes destinées, les autres vers les affres et les tourments. On ne peut ignorer que le samsâra a été entendu par les bouddhistes eux-mêmes comme une vérité et le karma comme une loi naturelle et quasi physique. Le processus karmique serait une forme de justice immanente, où tout ce que nous ferons trouvera sa rétribution. Il expliquerait un certain nombre d’états, qu’ils soient heureux ou malheureux. Le muet en cette vie aurait inévitablement menti dans une autre vie ; le pauvre expierait quelques vols ou larcins commis dans ses existences antérieures. Plus généralement, les handicapés, les pauvres, les femmes mêmes, ne feraient que s’acquitter de leurs fautes. Évidemment, l’inscription du karma dans les lois de la nature conduit à une forme de déterminisme qui justifie et rationalise les souffrances.
Pourtant, à l’encontre de cette vision naturaliste, les traditions bouddhistes sont traversées par une autre perspective qui conçoit le dharma, non comme une doctrine qui dirait le vrai sur le monde, mais comme une démarche qui propose une orientation en ce monde (l’Orient étant ici l’éveil, conçu comme le dénouement irrévocable de l’angoisse et de la peur). Cette autre approche se trouve développée dans les Écritures indiennes des traditions de la Grandeur (mahâyâna). Le Sûtra du Lotus et le Sûtra de Vimalakîrti rejettent ainsi toute explication métaphysique, insistant en revanche sur l’habileté consommée du Bouddha à produire des dispositifs de langage. Dans cette perspective, l’association du karma et du samsâra, en intégrant la totalité des actes dans la sphère du devenir, doit être comprise comme un mythe.
Sous le vocable de mythe, il ne convient pas d’entendre une forme narrative plus ou moins élaborée (comme peut l’être la légende de Tristan et Iseult), mais une représentation collective qui structure l’existence des individus et des communautés. Ainsi, le triptyque de la création du monde, de la parole de Dieu et de l’humanité du Christ a formé des siècles durant le grand mythe structurant de l’Occident. Leur conjugaison n’a pas simplement proposé une relation singulière entre Dieu, l’Homme et la nature, elle a produit une société qui se pense en son devenir, avec ses institutions (l’Église et la royauté) et ses acteurs. Le mythe possède une fonction englobante, il interprète le monde et intègre la totalité du vivant en quelques signes. Il produit un imaginaire, des représentations, des valeurs ainsi que des attitudes et des comportements individuels et collectifs.
Comme plusieurs chercheurs l’ont relevé, une lecture attentive des récits canoniques et extra-canoniques du bouddhisme ancien montre que la soi-disant « loi » du karma n’a pas la rigueur qu’on lui prête trop facilement [1]. Car ces récits n’ont nul besoin d’être « vrais » pour être justes. Tout comme un roman ou un film, ils peuvent jouer de l’ellipse, comporter des incohérences ou des inconsistances. Leur puissance émotive (et motrice) ne se confond pas avec le plausible. Ils affirment que non seulement nos actes ont des conséquences objectives, mais qu’ils se réverbèrent dans notre subjectivité. Ils affirment un monde humain, riche de valeurs et de significations, de beautés et de tristesses, un monde dans lequel chacun joue à chaque instant la grandeur de sa vie.
Toute tentative de prouver ou d’infirmer le karma et le samsâra manque la signification de leur invisibilité et de leur invérifiabilité. Pour apprécier pleinement le langage du mythe, il nous faudrait également nous défaire d’une conception qui a longuement informé la pensée occidentale et qui dissocie la raison de l’imagination. Dans nos représentations culturelles, un mythe paraît toujours subordonné à la pensée intellectuelle ou philosophique, il ne peut être que la forme dégradée et obscurcie d’une véritable histoire ou bien encore l’expression d’un archétype. Cette dévalorisation débute avec les Grecs eux-mêmes qui opposaient le muthos au logos (le mythe à la vérité) alors que les termes, synonymes et interchangeables dans la haute antiquité grecque, désignaient simplement la parole. Le mythe n’est pourtant pas une forme inférieure ou antérieure de la pensée ; il s’agit d’une autre de ses modalités, productrice de sens et d’effets, qui doit être appréhendée dans sa propre fonction sans espérer d’autre vérité que son expression. Si des philosophes contemporains, Jacques Derrida, Paul Ricœur, Richard Rorty ou d’autres, ont reconsidéré la fonction mythique, leurs travaux n’ont pas suffi pour que nos âmes se réapproprient autrement les mythes. Il nous faudrait un autre mot qui soit à même de recoudre le muthos et le logos. En sanskrit, le terme de sûtra (au sens propre, « le fil ») évoque précisément cette couture. Dans ces formes littéraires et narratives, la parole du Bouddha fait sans cesse confluer la réalité et la fiction. Les dissocier serait une mésentente. Ainsi, le samsâra, où chacun endure le déplaisir et le plaisir, n’est pas une vérité mais un espace de signification. Les six mondes forment une géographie narrative qui permettent d’appréhender autrement le monde et de l’habiter. Ils n’ont nul besoin d’explication ni de justification.
Le mythe s’impose comme une vision collective qui sature le regard. Notre vision occidentale du déploiement de la condition humaine dans le temps et dans l’espace est bien différente de celle des Indiens. Les bouddhistes occidentaux ne peuvent approcher cet autre cadre de l’agir et du devenir que sous la forme personnelle de la croyance ou de l’incroyance. Malgré des positions parfois très accusées, la littérature et la réflexion sur le karma et les renaissances restent mineures dans les pays non asiatiques et ne font guère l’objet de débats. Cette vision cosmique est plus ignorée que critiquée, déniée ou revisitée, car elle ne signifie rien dans nos structures narratives. L’image des six mondes ne peut paraître qu’artificielle et aboutir au rejet, ou plus sûrement au désintérêt. Seule une lecture à neuf des sûtras qui maintiendrait l’indispensable suture entre la fiction et la réalité serait à même de restaurer l’entente du karma, sa valeur émotive, motrice et mobilisatrice.
Jamais l’association du karma et du samsâra ne devrait être comprise comme la justification d’une morale du devoir ou du conformisme. Le karma désigne le pouvoir de l’acte et non une croyance. Agir nous engage à nous extraire de la mécanicité de nos vies, non à l’acceptation ou à la démission qui ne créent que de l’indifférence. Dans sa dimension mythique, l’association offre une autre morale conçue comme un élargissement de la pensée et de l’agir. L’agir est l’expression d’un être qui se perçoit vivant dans le monde. Ce que je suis se transforme alors en ce que je fais, et ce que je fais n’est rien d’autre que ce monde où je vis. Le désir dans son émergence fabrique le monde, mais plongé dans ce monde, celui-ci affecte, construit et reconduit mon existence. Telle est, pour un disciple du Bouddha, la signification de la renaissance.
Nul ne renaît seul. Ce monde n’est pas le domaine solitaire de quelques agissements personnels, il est un monde partagé. En agissant, non seulement je m’engage en ce monde, mais j’engage à mon tour, même dans le plus infime de mes actes, un à un, tous les êtres qui s’y meuvent. Nos actes ont une épaisseur et une gravité – une signification. Les domaines de renaissance désignent aussi des espaces d’interlocuteurs. Ils peuvent non seulement interagir mais également interpréter le sens de mes actes. Il s’agit de communautés d’interprétation.
Note 1 : James R. Egge, Religious Giving and the Invention of Karma in Theravâda Buddhism, Richmond, Curzon Press, 2002 ; Jessica Main, « The Karma of Others: Stories from the Milindapanha and the Petavatthu-atthakathâ », Journal of Buddhist Ethics, 2005.
Mots-clés : grandeur, karma, réincarnation, sûtras, transmigration
| Imprimer | Articlé publié par Jiun le 15 Août 12 |