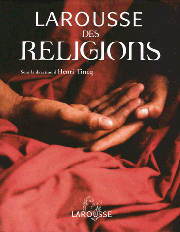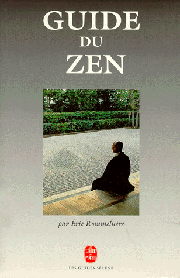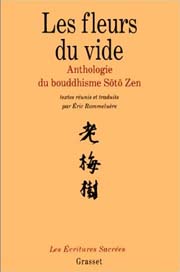une vision non-névrotique du dharma
Je participais la semaine dernière à un séminaire de formation d’aumôniers. Une psychanalyste fit une intervention sur les troubles psychologiques en prison, ceux des détenus ainsi que les troubles produits par l’incarcération. Elle présenta la nosologie courante : la névrose, la psychose, la perversion et les états-limites. Ses quelques mots sur la névrose m’interpellèrent, bien qu’elle ne s'appesantit pas sur la question. La névrose, disait-elle, est la condition ordinaire de l’être humain, nous tentons de nous débrouiller dans la vie avec plus ou moins de bonheur et et de malheur. Il n’y avait pas grand chose à en dire et elle conclut brièvement par un «nous sommes tous des névrosés» pour présenter longuement les troubles psychotiques.
Mais sa description de la névrose correspondait parfaitement à ce que les disciples des bouddhas appellent le samsâra, «le cercle de la vie et de la mort». Le samsâra est une maison aux fenêtres grandes ouvertes dont nous ne trouvons jamais la porte pour en sortir, alors nous tournons en rond et décorons la maison de blanc ou de noir pour occuper et supporter le temps qui passe. Cette psychanalyste caractérisait la névrose par deux aspects qui lui semblaient banals : la culpabilité et le besoin de sens. Ah, pensais-je, le dharma ne dit pas autre chose, mais pour montrer qu’il s’agit bien de la condition ordinaire dont il convient de se libérer.
Notre pratique est en effet fondée sur la reconnaissance, l’acceptation, l’intégration et le libération de nos égarements. La culpabilité est l’entrave absolue, celle qui enferme dans le passé alors que l’exercice du dharma est une réorientation de notre rapport au temps : nous sommes convertis à l’avenir et à l’infini de ses possibles. On l’exprime notamment dans les rituels d’engagement par la répétition d’une formule de repentir. Le repentir doit nécessairement précéder la prise de refuge ou la prise de préceptes. On ne peut s’engager à travailler, à changer (dans le futur) si on ne reconnaît pas d'abord ce que l’on est et ce que l’on a été (dans le passé). Nous assumons pleinement notre être dans la multitude de ses aspects même si nous avons commis des erreurs ou fait du mal, mais sans trace de culpabilité.
La question du sens est au cœur de l’enseignement des bouddhas. Cet enseignement pourrait être simplement résumé de la façon suivante dans un langage moderne : L’être humain est un être de langage qui échaffaude un réseau de significations, personnel et partagé, pour lui permettre de supporter sa condition. Les bouddhas répondent eux, non en proposant de nouvelles significations, de nouveaux concepts, mais en laissant se déployer une condition non-névrotique. Du point de vue de la condition névrotique, c’est un non-sens.
Et c’est bien cela. On débute par exemple par la méditation. On s’assoit en tentant d’échapper à toutes les significations que l’on pourrait ajouter à la seule assise : cela va me faire du bien, cela va m’aider, etc. Non. Il s’agit de s’asseoir immobile sans rien surajouter. S’asseoir sans intention, sans comparer, sans juger. On n’y arrive guère, et les méditants passent beaucoup de temps assis à circuler dans leur espace névrotique. Ils s’assoient et ils pensent, qu’il s’agisse d’un discours structuré ou de quelques pensées qui passent de-ci de-là lorsque l’instance ordonnatrice du moi se plie plus docilement au jeu de la méditation. Mais ce n’est pas là la libération. Il est de tradition dans le zen de dire qu’il faut trente ans pour se libérer par l’assise. Les couches névrotiques sont si puissantes, si invisibles, que le travail de sape est ardu, presque impossible. L’être résiste inconsciemment et de partout, car il pressent qu’au sens ne pourrait se substituer que l’insensé et la confusion. Alors, on préfère rester à la maison, à l’intérieur tantôt blanc tantôt noir. Même si des marches de l’escalier sont cassées, on a appris à les contourner. Même si une pièce est sale, on a appris à l'éviter. Mais en s’ouvrant à l’absence de névrose, on voit que la maison avec toutes ses configurations n’est qu’une construction sécurisante pour tenter de supporter sa fragilité et sa vulnérabilité. Certes, elle jugule l’angoisse mais elle ne la libère pas.
Si l’on considère que l’enseignement des bouddhas est un système de pensée, une religion ou une spiritualité que l’on pourrait comparer avec d’autres, à laquelle on pourrait adhérer ou non, on demeure dans une vision névrotique du dharma. Bien entendu, les bouddhas savent le besoin de sens de tout être humain et leurs discours s’inscrivent nécessairement dans des réseaux de signification. On ne peut explorer, dénouer la névrose qu’en parlant le langage de la névrose. Mais croire, par exemple, que les bouddhas professent la réincarnation comme une réalité à laquelle ils croient serait une méprise. Ils répondent simplement au besoin de sens et s’appuient dessus pour ouvrir l’espace du non-sens.
Autrement dit, qu’ils parlent ou qu’ils se taisent, les bouddhas sont toujours silencieux.
Mais sa description de la névrose correspondait parfaitement à ce que les disciples des bouddhas appellent le samsâra, «le cercle de la vie et de la mort». Le samsâra est une maison aux fenêtres grandes ouvertes dont nous ne trouvons jamais la porte pour en sortir, alors nous tournons en rond et décorons la maison de blanc ou de noir pour occuper et supporter le temps qui passe. Cette psychanalyste caractérisait la névrose par deux aspects qui lui semblaient banals : la culpabilité et le besoin de sens. Ah, pensais-je, le dharma ne dit pas autre chose, mais pour montrer qu’il s’agit bien de la condition ordinaire dont il convient de se libérer.
Notre pratique est en effet fondée sur la reconnaissance, l’acceptation, l’intégration et le libération de nos égarements. La culpabilité est l’entrave absolue, celle qui enferme dans le passé alors que l’exercice du dharma est une réorientation de notre rapport au temps : nous sommes convertis à l’avenir et à l’infini de ses possibles. On l’exprime notamment dans les rituels d’engagement par la répétition d’une formule de repentir. Le repentir doit nécessairement précéder la prise de refuge ou la prise de préceptes. On ne peut s’engager à travailler, à changer (dans le futur) si on ne reconnaît pas d'abord ce que l’on est et ce que l’on a été (dans le passé). Nous assumons pleinement notre être dans la multitude de ses aspects même si nous avons commis des erreurs ou fait du mal, mais sans trace de culpabilité.
La question du sens est au cœur de l’enseignement des bouddhas. Cet enseignement pourrait être simplement résumé de la façon suivante dans un langage moderne : L’être humain est un être de langage qui échaffaude un réseau de significations, personnel et partagé, pour lui permettre de supporter sa condition. Les bouddhas répondent eux, non en proposant de nouvelles significations, de nouveaux concepts, mais en laissant se déployer une condition non-névrotique. Du point de vue de la condition névrotique, c’est un non-sens.
Et c’est bien cela. On débute par exemple par la méditation. On s’assoit en tentant d’échapper à toutes les significations que l’on pourrait ajouter à la seule assise : cela va me faire du bien, cela va m’aider, etc. Non. Il s’agit de s’asseoir immobile sans rien surajouter. S’asseoir sans intention, sans comparer, sans juger. On n’y arrive guère, et les méditants passent beaucoup de temps assis à circuler dans leur espace névrotique. Ils s’assoient et ils pensent, qu’il s’agisse d’un discours structuré ou de quelques pensées qui passent de-ci de-là lorsque l’instance ordonnatrice du moi se plie plus docilement au jeu de la méditation. Mais ce n’est pas là la libération. Il est de tradition dans le zen de dire qu’il faut trente ans pour se libérer par l’assise. Les couches névrotiques sont si puissantes, si invisibles, que le travail de sape est ardu, presque impossible. L’être résiste inconsciemment et de partout, car il pressent qu’au sens ne pourrait se substituer que l’insensé et la confusion. Alors, on préfère rester à la maison, à l’intérieur tantôt blanc tantôt noir. Même si des marches de l’escalier sont cassées, on a appris à les contourner. Même si une pièce est sale, on a appris à l'éviter. Mais en s’ouvrant à l’absence de névrose, on voit que la maison avec toutes ses configurations n’est qu’une construction sécurisante pour tenter de supporter sa fragilité et sa vulnérabilité. Certes, elle jugule l’angoisse mais elle ne la libère pas.
Si l’on considère que l’enseignement des bouddhas est un système de pensée, une religion ou une spiritualité que l’on pourrait comparer avec d’autres, à laquelle on pourrait adhérer ou non, on demeure dans une vision névrotique du dharma. Bien entendu, les bouddhas savent le besoin de sens de tout être humain et leurs discours s’inscrivent nécessairement dans des réseaux de signification. On ne peut explorer, dénouer la névrose qu’en parlant le langage de la névrose. Mais croire, par exemple, que les bouddhas professent la réincarnation comme une réalité à laquelle ils croient serait une méprise. Ils répondent simplement au besoin de sens et s’appuient dessus pour ouvrir l’espace du non-sens.
Autrement dit, qu’ils parlent ou qu’ils se taisent, les bouddhas sont toujours silencieux.
Roger-Pol Droit, Le silence du Bouddha, Sagesses bouddhistes (diffusion du 30 septembre 2012)
Mots-clés : névrose, réincarnation, samsâra
| Imprimer | Articlé publié par Jiun le 04 Oct. 12 |