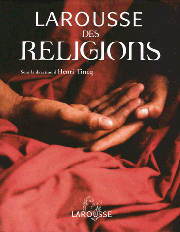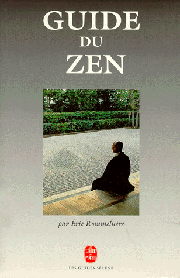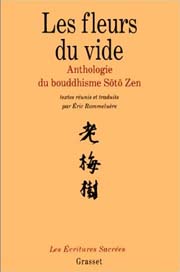Retrouvez moi au Refuge du Plessis

25 Fév. 2025
Chers amis,
Ce blog est appelé à disparaître d'ici peu. Tous les articles ont été transférés sur le site internet du Refuge du Plessis. Vous pouvez m'y retrouver.
Le Refuge du Plessis est un temple bouddhiste où les pratiques du dharma se conjuguent avec les pratiques d'une écologie résiliente. Cela se passe dans le sud du département de la Sarthe : Le Refuge du Plessis (cliquez).
Les mains jointes, Jiun (Éric Rommeluère)